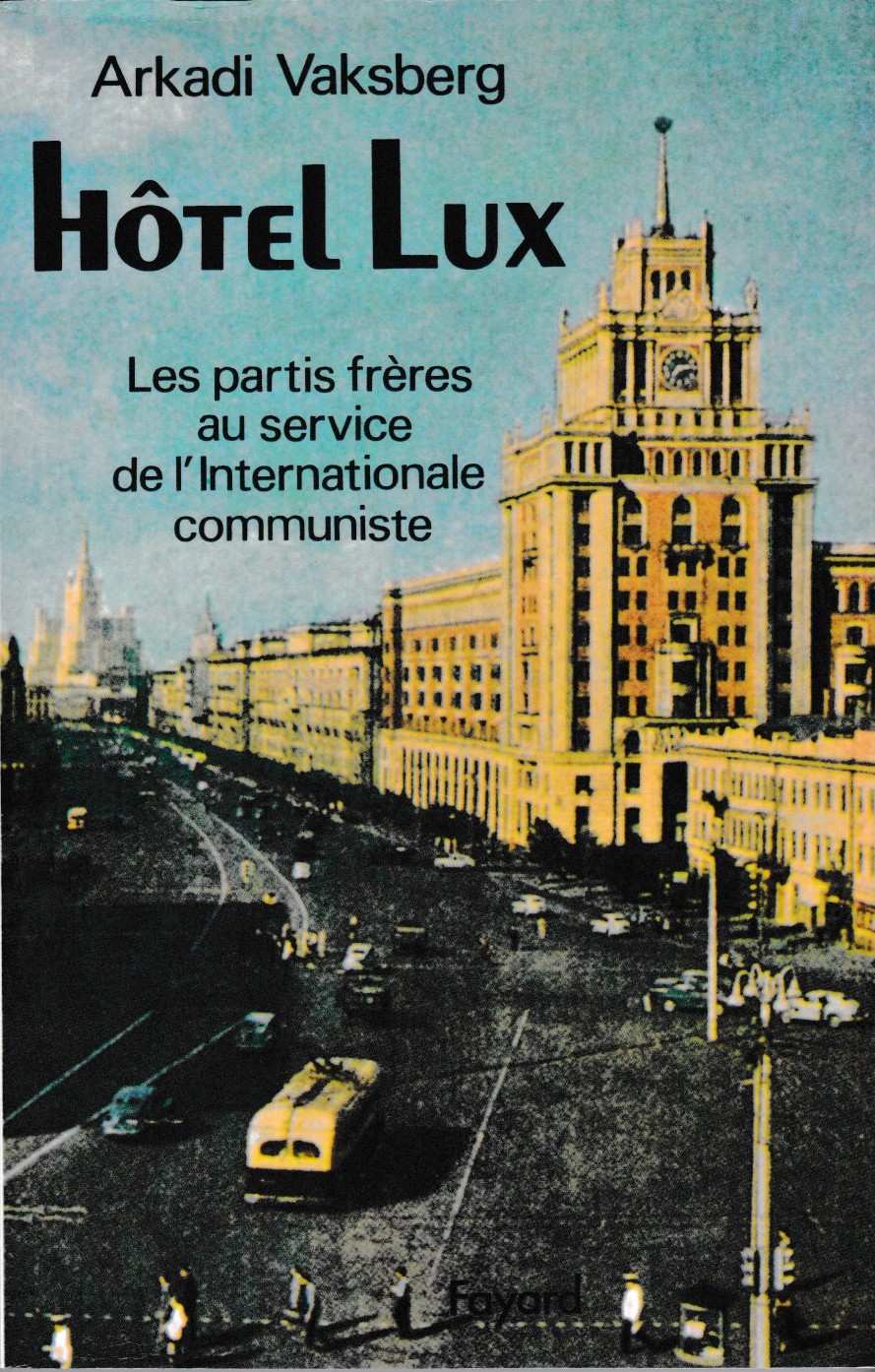La relecture d’Hôtel Lux (1), ouvrage du journaliste et écrivain russe Arkadi Vaksberg (1927–2011), s’impose à quiconque s’intéresse à l’histoire du communisme et aux mécanismes répressifs du stalinisme. Dans cette étude, Vaksberg met en lumière, à partir de documents extraits des archives secrètes soviétiques, le fonctionnement interne de la machine de terreur orchestrée par Staline. Son expérience de la vie quotidienne en URSS, son acharnement à dénoncer certaines dérives criminelles et sa plume engagée confèrent à son analyse une portée singulière. Vaksberg ne regarde pas le système soviétique comme une entité extérieure, mais comme une partie de lui-même, de son histoire familiale, politique, intellectuelle. Et pour nous la relecture d’Hôtel Lux s’impose d’autant plus que, parmi les affaires décortiquées au fil de l’ouvrage, figure le cas Willi Münzenberg, personnalité bien connue au Mas du Barret. Le récit, riche en informations inédites enfouies dans les coffres-forts du Komintern, concerne notamment le drame du bois du Caugnet à Montagne en 1940. Au-delà, le livre montre que Münzenberg ne se réduit pas à la vision occidentale d’une personnalité qui pèse sur la scène politique internationale de l’entre-deux guerres grâce à ses talents et ses engagements. Sous l’ère stalinienne, explique Arkadi Vaksberg, un communiste disposant comme lui de fonctions et de pouvoirs importants était inéluctablement voué à un destin tragique.
D’abord lieu de résidence principal des révolutionnaires étrangers affiliés à l’Internationale communiste (Komintern), l’Hôtel Lux devient dans les années 1930 un lieu de répression étroitement lié au NKVD (« Commissariat du peuple aux Affaires intérieures », ancêtre du KGB). Le sous-titre du livre de Vaksberg, « Les partis frères au service de l’Internationale communiste », rappelle que, dans le langage codé de l’ère soviétique, les « partis frères » étaient alignés sur les positions idéologiques et stratégiques de l’URSS ou de son parti communiste. C’était le cas notamment du Parti communiste d’Allemagne (KPD) dans lequel Müzenberg a joué un rôle important. Autrement dit, dans la logique stalinienne et par le simple fait de son implication dans le KPD, Münzenberg était nécessairement au service de l’Internationale communiste, et ce indépendamment des relations entretenues avec elle dans le cadre de ses activités politiques internationales. Münzenberg, on le sait, fut un maître de la propagande politique durant l’entre-deux-guerres, grâce notamment à sa capacité à mobiliser les masses et à influencer l’opinion publique en faveur de l’URSS et du communisme. Pour autant était-il le servile amplificateur de la voix de Moscou ? Ce serait alors faire l’impasse sur son intelligence, sa capacité à se réinventer, et son souci éclairé par l’opposition à Hitler d’échapper à toute forme de totalitarisme.
À ces analyses, fondées, en partie tout au moins, sur les traits de caractères, les talents personnels, les choix idéologiques de Münzenberg, Arkadi Vaksberg préfère une approche plus large, certains diront plus systémique. Pour lui, Münzenberg émerge parce qu’il est utile au système soviétique, il s’avère « déviant » dès lors que le système lui-même, emporté par sa propre dynamique, devient paranoïaque, sa disparition pourrait s’inscrire dans une logique de liquidation politique qui broie les victimes et leurs bourreaux tout comme ceux qui, bien que n’ayant ni parlé ni agi, sont pour cela jugés objectivement complices des ennemis du moment. Tout membre du Parti qui cesse d’être parfaitement aligné sur la doctrine, les règles et la phraséologie officielles devient aussitôt un suspect en puissance. Ainsi, dès lors qu’il prend, dans les années 1930, ses distances avec le Komintern – notamment après les procès de Moscou et le pacte germano-soviétique -, Münzenberg devient-il une menace à neutraliser. C’est dans le chapitre « La mort de ceux qui avaient compris », que Vaksberg dévoile ses « trouvailles » sur la disparition de Münzenberg, non sans avoir au préalable salué le courage de celui qui a su résister à Staline.
Avant d’aller plus loin, il convient de statuer sur deux affirmations erronées qui nous conduisent à mettre sérieusement en perspective les informations fournies par Vaksberg. Celui-ci confond le camp de Vernet, dans l’Ariège, avec celui de Chambaran, dans l’Isère. D’autre part, il écrit qu’avant de mourir Münzenberg avait été soumis à des tortures et des supplices féroces à un point tel que l’identification de son corps mutilé avait pris des mois. A l’évidence Vaksberg n’a pas cherché à se renseigner sur l’existence de données officielles rendant compte de la découverte du corps de Münzenberg. Il existe pourtant des documents irréfutables tels que le rapport de gendarmerie du 18 octobre 1940, conservé aux Archives départementales de l’Isère. Certes Vaksberg était un homme courageux qui a risqué sa vie en dénonçant les assassinats ou les morts inexpliquées sous Staline puis, au début des années 2000, le retour des méthodes radicales d’élimination réservées aux opposants dans la Russie post-soviétique. Nous ne devons toutefois pas oublier qu’il est journaliste et écrivain de romans historiques, et non historien « scientifique ». Par exemple, le récit romanesque du corps mutilé de Münzenberg révèle une certaine disposition à « combler les vides » avec des reconstructions conjecturales hasardeuses, pour ne pas dire de pures affabulations. Pour autant, cela ne signifie pas que tout ce qu’écrit Vaksberg est à jeter aux orties. Plusieurs historiens de la Russie contemporaine soulignent son rôle précieux pour ouvrir des pistes et proposer des hypothèses fortes, tout regrettant son manque de rigueur méthodologique, son recours excessif à des témoignages indirects ou des documents dont l’authenticité n’est pas clairement établie, son ton parfois sensationnaliste, plus proche du journalisme d’opinion que de l’histoire scientifique (2). Les déclarations de Vaksberg sont « à peser comme de l’or », selon l’expression joliment imagée de nos voisins allemands. Chaque milligramme, ici chaque détail, compte et doit être examiné avec la plus grande prudence. Et quand bien même les déclarations de Vaksberg seraient-elles entièrement fiables que nous apprendraient-elles sur la disparition de Münzenberg à Montagne ?
Comme nous l’avons vu, il serait tout aussi imprudent de prendre pour argent comptant les affirmations de Vaksberg que malavisé de négliger les indices qu’il propose. Voici donc ci-dessous, en substance et dans le style des fiches qu’il retranscrit, les éléments que l’on peut retenir de son récit. Par souci de clarté, l’analyse du passage concerné distinguera ce qu’écrit précisément l’auteur et l’interprétation que l’on peut en faire.
Commençons par ce qu’écrit Waksberg d’après les dossiers qu’il a consultés. Le point de départ de la traque de Münzenberg par les tueurs de Staline est le 6 mai 1939, jour où Comité central du Parti communiste d’Allemagne l’a exclu. Le 18 décembre 1943, l’un des chefs du NKVD adresse à la Loubianka, terme générique pour désigner les services secrets soviétiques, une demande de renseignements sur quatre individus (3). La liste est caractéristique sur un point. Münzenberg y figure modestement en deuxième place en compagnie de noms strictement inconnus : Ignat Goldstein, né en 1915 originaire de Vienne, juif, ressortissant polonais ; Moïse Rechal, né en 1907, originaire de Riga, juif, vivait à Paris depuis 1928, a adhéré au PCF en 1936, a participé à des activités des Amis de l’association des amis de l’URSS ; Samuel Spivak, né en 1899, juif originaire de Russie, aurait participé en 1922 au Congrès du Komintern. Les quatre hommes se sont enfuis ensemble du Camp de Vernet. La réponse à la demande du 18 décembre 1943 n’apporte aucune information sur Golstein et Spivak, elle donne en revanche des éléments conduisant à penser que Rechal est un homme du NKVD. Dans le dossier dudit Rechal, retrouvé dans les archives secrètes du Komintern, figure une coupure du journal suisse Volksrecht du 29 novembre 1940 indiquant la découverte du corps de Münzenberg.
Venons-en à l’analyse des éléments cités par Vaksberg. Une clarification tout d’abord. Pourquoi un dirigeant du NKVD demande-t-il en 1943 à la Loubianka de lui communiquer des renseignements sur quatre individus dont l’un au moins, Rechal, appartenait au NKVD en 1940 ? Selon Vaksberg, le NKVD n’aurait été informé que par la bouche des tueurs eux-mêmes et désirait obtenir la preuve absolue de la mort de Münzenberg en feignant d’être étranger à l’affaire. Notons au passage l’emploi du pluriel : plusieurs tueurs sont impliqués. Par rapport à ce qui s’est passé à Montagne en juin 1940, ce que révèle Vaksberg appelle deux commentaires. Premièrement, les informations sur les trois individus signalés comme évadés du Camp de Chambaran en compagnie de Münzenberg ne comportent aucun détail anthropométrique. Il est par exemple impossible d’affirmer si, oui ou non, le jeune homme roux signalé par plusieurs témoins (4) est l’un d’eux. Deuxièmement, la date du 6 mai 1939 attire notre attention sur le calendrier opérationnel de l’élimination physique de Münzenberg. Pour quelle raison précise et à quel moment le NKVD s’est-il mis en mouvement pour exécuter la sentence ? Le journal personnel de Dimitrov indique, à la date du 11 novembre 1937, que Staline en personne a pris la décision fatale (5). L’élément déclencheur, ou plus exactement le prétexte car, ainsi que cela a été mentionné, Münzenberg, communiste en pointe sur la scène internationale, membre du Comité central du KPD, était dans la logique stalinienne irrémédiablement condamné, serait-il la publication, dans le journal Die Zukunft daté 22 septembre 1939, d’un article à la conclusion incendiaire : « Le traître, Staline, c’est toi. » ? C’est une option souvent mise en avant (5). Mais alors, les redoutables tueurs du NKVD auraient mis presque neuf mois, du 22 septembre 1939 au 20 juin 1940, pour atteindre une cible aussi visible que Münzenberg ? Une cible qui, bien qu’étant sur ses gardes et se protégeant, restait vulnérable dans cette période de bouleversements
En définitive, peut-on trouver dans Hôtel Lux des informations déterminantes pour résoudre l’énigme de la mort de Münzenberg ? Force est de constater que Vaksberg ne fournit aucun élément qui puisse justifier des certitudes. Sur le plan des faits, rien de décisif : les dossiers des archives secrètes soviétiques sont à notre avis de nature à alimenter des supputations, pas des certitudes. Quant à la thèse de la « machine stalinienne », dont nous avons reconnu l’éclairage original et somme toute intéressant qu’elle porte sur Münzenberg, elle débouche sur une question qui donne le vertige. Si effectivement une mort violente, qui plus est justifiable dans la mécanique stalinienne par un ou des prétextes factuels, était programmée, alors on cherche encore la justification rationnelle de la date, du lieu et des modalités d’intervention du NKVD.
Hôtel Lux est un livre à relire avec un œil critique. Entachée de deux erreurs lourdes – la confusion entre les camps de Vernet et de Chambaran, l’état du corps du Münzenberg à sa découverte -, la démonstration de Vaksberg n’est pas concluante par ailleurs. Elle n’apporte aucun élément de preuve irréfutable sur l’identité du (ou des assassins) ni sur le mode opératoire de son (leur) forfait. Je reste sur les deux conclusions que j’ai toujours défendues. L’une relève de la conviction. Quelles qu’aient pu être les vicissitudes du moment, un Münzenberg rompu de longue date à tous les exercices de survie d’un homme exposé au danger n’a pu se monter imprudent au point d’accepter naïvement pour compagnon le premier venu dans sa fuite vers la liberté. L’autre relève de la certitude. Personne à ce jour ne peut dire ce qui s’est exactement passé dans le bois du Caugnet le 20 juin 1940. L’énigme de la mort de Münzenberg reste entière.
Michel Jolland, contributeur à la recherche participative (6)
NOTES
1. Vaksberg, Arkadi, Hôtel Lux. Les partis frères au service de l’Internationale communiste. Paris, Fayard, 1993.
2. Sur la nécessité de relire avec prudence Vakberg et les premières publications post-soviétiques, voir : Keep, John. Review of Stalin Against the Jews by Arkady Vaksberg. The Russian Review, Vol. 54, No. 4 (Oct., 1995), pp. 613–614; Thom, Françoise. La Crise de l’URSS. Paris, Perrin, 1997, p. 288 ; Werth, Nicolas, La Terreur et le désarroi. Staline et son système. Paris, Perrin, 2007, p. 10 ; Snyder, Timothy. Terres de sang . Paris, Gallimard, 2012, p. 389.
3. Vaksberg, Hôtel Lux, pp.191-192.
4. La présence intrigante de ce jeune homme roux est signalée par Babette Gross dans son ouvrage de référence : Willi Münzenberg, Eine Politische Biografie. Sttutgart, Deutsche Verlagsanstalt, 1967. Toutes les publications sur la mort de Münzenberg reprennent et analysent cette donnée, voir par exemple : Dugrand, Alain et Laurent, Frédéric. Willi Münzenberg, artiste en révolution. Paris,Fayard, 2008, p. 558.
5. Georgi Dimitrov, journal 1933-1949. Mentionné par Dugrand et Laurent (opus cité), p. 475.
6. « En octobre 1939 il n’hésite pas à faire paraître à la une de son journal L’Avenir et sur huit colonnes « Staline, c’est toi le traître », signant ainsi son arrêt de mort. », fiche Willi Münzenberg in 1939-1945, L’Isère en Résistance. Grenoble, éditions Le Dauphiné Libéré, 2005, pp. 116-117.
7. L’opposition entre journalisme d’opinion et histoire scientifique, mentionnée au sujet de Vaksberg, renvoie à une question plus large sur la qualification des textes touchant à l’histoire. Sur l’axe qui s’étend de la pure fiction historique jusqu’aux publications universitaires ou d’historiens reconnus, en passant par le journalisme d’investigation, les travaux d’érudits locaux ou d’entrepreneurs de mémoire autodidactes, la recherche participative, il existe une catégorie de contributions en quête de statut épistémologique et social. Ce sont des contributions qui, sans pouvoir revendiquer l’armature méthodologique et conceptuelle conférée par un sceau universitaire ou institutionnel, se veulent rigoureuses et précises. Le texte proposé ici en fait partie.